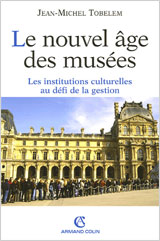 Que les grandes institutions culturelles publiques soient des organisations, redevables en tant que telles d’une analyse de leur fonctionnement, de leur développement et de leurs modalités de financement, voilà qui ne devrait guère souffrir de contestation. Ce simple point suffirait du reste à justifier d’intenses réflexions visant à leur permettre de remplir avec encore davantage d’efficacité les missions – complexes – qui leur sont confiées par la collectivité publique : conservation, étude, recherche, diffusion, création, etc. Mais ces légitimes (et parfois indispensables) mouvements de modernisation au service des fins de l’institution conduisent certains à estimer que les institutions culturelles telles que les musées ou les monuments seraient devenues… des entreprises. Voilà un pas qui paraît franchi avec un peu trop d’empressement.
Que les grandes institutions culturelles publiques soient des organisations, redevables en tant que telles d’une analyse de leur fonctionnement, de leur développement et de leurs modalités de financement, voilà qui ne devrait guère souffrir de contestation. Ce simple point suffirait du reste à justifier d’intenses réflexions visant à leur permettre de remplir avec encore davantage d’efficacité les missions – complexes – qui leur sont confiées par la collectivité publique : conservation, étude, recherche, diffusion, création, etc. Mais ces légitimes (et parfois indispensables) mouvements de modernisation au service des fins de l’institution conduisent certains à estimer que les institutions culturelles telles que les musées ou les monuments seraient devenues… des entreprises. Voilà un pas qui paraît franchi avec un peu trop d’empressement.
En effet, musées et monuments – dont les plus importants sont devenus autonomes – ont beau chercher de nouvelles sources de revenus, gérer des équipes plus nombreuses et nouer des partenariats inédits, leur découverte du marketing et du management (la communication étant quant à elle à l’œuvre depuis longtemps) ne saurait en tout état de cause les transformer en entreprises, fussent-elles culturelles. La raison fondamentale tient au fait que ces institutions demeurent des organisations sans but lucratif et sans perspective réaliste de dégager des bénéfices, compte tenu des (coûteuses) missions de service public qu’elles remplissent et qui ne permettent pas de réaliser un profit. Du reste, même si ce dernier existait, il ne serait pas distribué à des actionnaires, comme c’est le cas pour les entreprises commerciales. C’est pourquoi, rappelle avec justesse Thierry Giappiconi à propos de la responsabilité du bibliothécaire, « il ne lui sied pas de jouer au chef d’entreprise, sans risques, sans profits et sans légitimité ni économique ni publique » (« La tarification et ses masques », BBF, n°2, 1993).
En dépit d’une orientation parfois nettement « entrepreneuriale » et d’un louable souci d’évaluer le résultat de leurs actions (qui n’est nullement propre au secteur à but lucratif), les musées – comme les bibliothèques publiques – appartiennent assurément au secteur non marchand, même s’ils peuvent développer, à titre secondaire, des activités de nature commerciale dont les surplus seront utilisés pour mieux remplir leurs missions culturelles, scientifiques ou éducatives. On peut par ailleurs soutenir qu’une offre culturelle qui ne rencontrerait aucune « demande » de la part du public ne répondrait qu’imparfaitement à sa mission, dont l’une des composantes est de s’adresser au public le plus large possible. C’est ici précisément qu’intervient la question de la tarification.
On observe en effet que le prix d’accès aux équipements culturels n’a cessé de progresser ces dernières années, bien au-delà de l’inflation ; cette augmentation est certes justifiée par des besoins financiers croissants, voire par l’importance du tourisme international, mais elle pose de plus en plus la question de l’accès d’un nombre croissant de personnes à une activité qui devient « chère », au risque que certains individus renoncent purement et simplement à la visite d’un musée, d’un monument ou d’une exposition ; ou bien – attitude également dommageable du point de vue de l’intérêt public – diminuent la fréquence de leurs visites, ce qui serait contraire aux objectifs de politique culturelle que doivent mettre en œuvre les institutions culturelles au bénéfice de l’intérêt général.
À cet égard, il semble que l’on devrait établir les principes de la tarification publique en se demandant non pas quel est le seuil maximal « acceptable » par les visiteurs, mais plutôt le montant strictement nécessaire au fonctionnement adéquat de l’équipement, ce qui constituera un moindre mal en termes d’ouverture à un large public. Voire, quand cela est possible, en jouant la carte de la gratuité pour favoriser l’accroissement du nombre de visites, même si l’on sait que le prix n’est pas le seul facteur qui contribue à éloigner de l’offre culturelle diverses catégories de la population. Or, il est maintenant établi que le renoncement de certains musées au paiement de droits d’entrée ne les empêche aucunement de développer une offre périphérique payante, capable de créer des ressources significatives, qu’il s’agisse de boutiques ou de lieux de restauration (mais également de recourir au mécénat et à la location d’espace).
Cette approche permet de distinguer clairement les fins des institutions culturelles et les moyens nécessaires à leur accomplissement, qui ne peuvent être placés au même niveau. En disant cela, nous gardons bien sûr à l’esprit que la responsabilité des chefs d’établissement est de gérer du mieux qu’il est possible les moyens mis à leur disposition par la collectivité publique, ce qui passe sans doute par une réflexion sur les modalités de leur formation dans le domaine de la gestion.
[1] Auteur de « Musées et culture, le financement à l’américaine » (PUL) et « Le nouvel âge des musées, les institutions culturelles au défi de la gestion » (Armand Colin), co-responsable de la publication (avec M.-O. de Bary) du « Manuel de muséographie, petit guide à l’usage des responsables de musée » (Séguier-Atlantica) et éditeur de l’ouvrage collectif « La culture mise à prix, la tarification dans les sites culturels » (L’Harmattan), responsable de la collection « gestion de la culture » chez l’Harmattan, Jean-Michel Tobelem, docteur en gestion, est directeur d’Option Culture.

